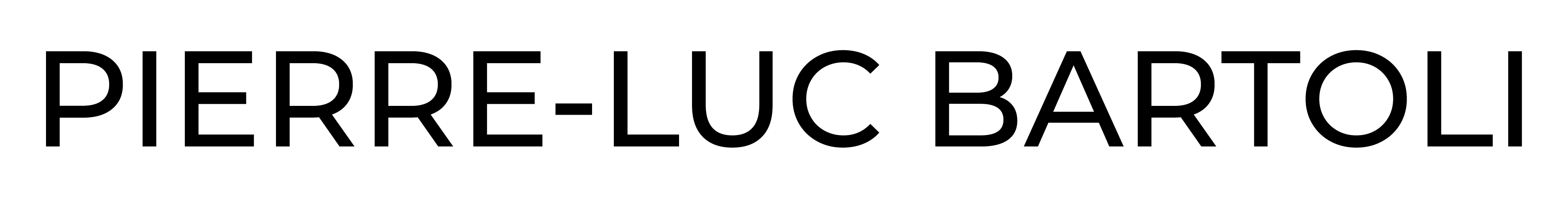On m’avait dit ce sont des paysages et sans m’en rendre compte je m’étais mise à attendre du ciel, de la mer, du bleu, un astre, de l’oxygène et éventuellement, va savoir, l’été. On n’avait pas précisé la focale et je vois bien, une fois précipitée dedans tête la première : ce sont des paysages. Pourtant ils sont si près que je les hume, les arbres ont des yeux profonds et des bras et des jambes, ils ont une carapace de peau rêche et terreuse et font mine, parfois, de serrer autour de mon cou. Ou bien, tête coupée, ils narguent le visiteur de leur gloire passée.
Certains se déhanchent au vent, semblent danser. D’autres sont insondables, minéraux, secs, tendus vers rien, le vent qui passe à travers la montagne ne parvient pas, dirait-on, à troubler leur fierté. Ou bien les a-t-il déjà rendus fous. Ceux-là sont peut-être morts. Je respire leur odeur de brûlé mouillé, et parfois leurs ronces m’éraflent la main. Ce sont de longs doigts de sorcière qui s’entrelacent et laissent filtrer un peu de bleu. Un ruisseau. On s’y casserait la figure. On aurait les genoux pleins de boue. On glisserait sur leurs feuilles déjà plus très vertes ou carrément jaunies. Leurs membres croisés dessinent une fenêtre, un cadre, un triangle. On devine à travers le mikado des branches le bleu du ciel et le vert doux des fougères. Une lumière perce le rideau de leurs cheveux. C’est une barrière ou un belvédère. Un interdit et une invite. Il suffit d’enjamber.
Le parcours est sinueux, escarpé. Silhouettes inégales. Tronc moussu et sensuel, colosse aux airs de baobab, tronc calciné dans la tempête. Chorégraphie vespérale tout bouge autour mais l’arbre ne plie pas. Les pins n’ont rien de parasol, ils se tendent parfois vers le ciel comme des clochers ou des sexes. Il y a du rugueux, du brutal, dans le sentier à hauteur d’homme. C’est surtout la peau, la texture de la peau. Veinée ou écartelée. Rêche. Epineuse. Sèche ou trempée, ici râpeuse. Les branches ici ont cassé dans un craquement sinistre. Les racines déplacent un rocher et les feuilles froissent. D’habitude en Corse j’entends la mer. Ici c’est surtout ce frisson des feuilles qui arrête le regard.
Ailleurs à flanc de montagne deux troncs jumeaux épineux comme les tiges des roses, un halo de soleil ou de lune vient les coiffer, les remettre à leur place. Le ciel rougit, l’incendie n’est pas loin. Les branches noircissent. Résine chauffée à blanc. Peindre les épines, leur flottement, leur balancement, leur entrechoc, comme elles crépitent aussi à terre sous tes pas. Une peinture synesthète, qui écorche tes mains et tes genoux. Tu avances en déblayant le chemin. Au fond tu découvres un mur, une construction humaine, trace d’une ancienne vie. Tu la contournes, tu l’explores. On n’entrera pas. Le calcaire des pierres fabrique un tombeau, une illumination. On ne voudrait pas troubler le repos. On va s’asseoir.
Quand le vent tombe on entend la source, la rivière, le torrent. Clapotis, micro-ressac entre les roches. C’est encore ici qu’il y a le plus de bleu. C’est un abri, ça respire, il fait presque frais. Ca dégouline, ça prend son temps. Un sentier, une clairière. Ca éloigne le vent. Ca t’enveloppe comme une cathédrale. Ca joue de la musique. Un nocturne, je ne sais pas, le Dio vi.
Je suis assise sur le sol froid dans l’atelier de l’artiste. C’est à Paris. Le labyrinthe de la montagne corse adossé au mur. Les pieds dans l’eau, torrent du trottoir d’en face. Dans le tombeau d’une vie ranimée par touches. Jaune immortelles. Brun châtaigneraie. Vert maquis. Rouge maquis. Blanc ruines. Depuis 2011 je visite régulièrement l’atelier parisien de Pierre-Luc Bartoli lors de mes escales en France. Des clubs, aux métros, aux rues parisiennes, j’y explore une géographie qui ne cesse de se décentrer, de s’émanciper du réel. Cette série est une Madeleine plus qu’un voyage. Elle réinvente des sensations et convoque un souvenir qu’elle distord, non pas à la façon des rêves, mais avec une rage de le faire advenir, de le proclamer ici et maintenant au bout des doigts, immédiatement présent et vivant sous la pulpe des doigts. Déplacement, condensation : le voyage ici est organique et sensuel. Je ferme les yeux et je touche, je vois, je hume, je caresse l’écorce – mes propres mains.
Claire Legendre, février 2017